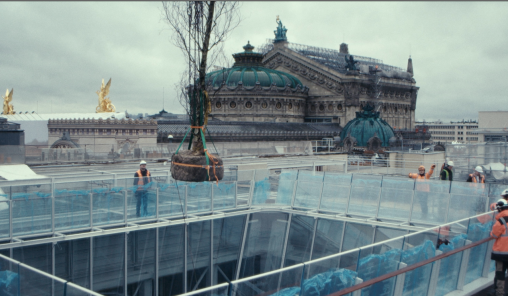MODE • Un fonds suisse pour la mode afin de limiter les effets néfastes de la fast-fashion, c’est ce que demande l’ONG Public Eye au Conseil fédéral. A Lausanne, une élue socialiste s’attaque à la question. Mais les leviers à l’échelle d’une ville sont limités.
«Le vêtement est devenu un produit jetable. Avec Shein ou Temu, nous parlons même d’ultra-fast fashion, avec des milliers de nouveaux produits mis en vente chaque jour», se désole Géraldine Viret, porte-parole pour la Suisse romande de l’ONG Public Eye. Mais les deux géants chinois ne sont de loin pas les seuls sur le banc des accusés de la fast fashion. Toute chaîne qui produit en masse des vêtements vendus généralement à prix modeste est un modèle d’affaires de fast fashion. H&M et Zara en ont été les précurseurs.
Passer à la caisse
Public Eye a remis le 1er octobre au Conseil fédéral une pétition munie de 34’600 paraphes, qui l’enjoint à prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre les effets néfastes de la fast fashion. Elle propose la création d’un fonds suisse pour la mode. «Il faut que les entreprises participent aux coûts sociaux et environnementaux des dommages causés par leur modèle d’affaires.» A savoir, l’exploitation des travailleurs qui se tuent à la tâche 75 heures par semaine pour un salaire dérisoire, mais aussi la pollution et l’exploitation des ressources naturelles. Le tout, subi dans des pays à faibles revenus.
A Lausanne, une élue s’est emparée de la question. «Une prise de conscience doit avoir lieu au sein des consommateurs», note la conseillère communale socialiste Gaëlle Mieli. Son postulat, déposé en mars 2025, demande à la Municipalité de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les dommages causés par la fast-fashion, notamment à destination des adolescents. «Car c’est à cet âge-là que l’on peut être le plus tenté d’acheter ces vêtements à très bas prix.»
Mais elle demande aussi à la Ville d’agir, par exemple en soutenant les différentes associations lausannoises engagées dans la vente de vêtements de seconde main, ceci afin de favoriser les circuits courts, mais aussi d’étudier l’opportunité de renforcer les possibilités de recyclage à l’échelle communale afin d’éviter d’exporter les textiles dans des pays étrangers. «Dans le contexte d’un marché global, sans mesures nationales, les leviers efficaces manquent» répond de son côté Stéphane Beaudinot, chef du service de la propreté urbaine à Lausanne.
Même en matière de soutien aux initiatives locales, la marge de manœuvre reste limitée. «Nous recevons une quantité énorme de demandes, complète le chef de service. Il est difficile de privilégier une initiative plutôt qu’une autre. D’autant qu’une ville doit veiller à son économie autant qu’au réemploi des matières. C’est un équilibre fragile.»
Selon Stéphane Beaudinot, il est particulièrement important que les acteurs privés se rassemblent.
Contribution incitative
«Je pense qu’une ville a une responsabilité dans cette transition, poursuit Isa Boucharlat, co-fondatrice de la Trame, qui propose une boutique de seconde main, un service de réparation textile ainsi que des cours de couture, à Lausanne. Il faut des soutiens financiers pour ces initiatives car ce sont des systèmes économiques différents, qui reposent souvent sur le bénévolat, et ce n’est pas viable à long terme.»
C’est pourquoi Public Eye propose que pour chaque nouveau vêtement produit et vendu sur le marché suisse, les entreprises versent une contribution au fonds. Ainsi, les initiatives positives dans le domaine de la circularité des textiles pourraient être davantage soutenues, grâce à un cadre politique.
Le fonds servirait également à promouvoir la recherche et une production textile plus durable, qui inciterait, - c’est en tout cas l’espoir de l’ONG Public Eye - , les grandes entreprises à produire plus durablement puisque la contribution financière serait proportionnelle à la durabilité des vêtements qui sont mis sur le marché.
Prise de conscience collective
L’amélioration de la collecte, du recyclage, du réemploi ou encore de la vente de seconde main est importante, mais pas suffisante en soi, encore moins dans un contexte où les financements manquent (lire encadré): «Si l’on considère les quantités astronomiques de vêtements produits et jetés chaque année, aucun système de recyclage actuel ne pourrait absorber de tels volumes», note Géraldine Viret.
Elle poursuit: «Les solutions ne viendront pas des géants de la mode. Une véritable prise de conscience collective est nécessaire. Mais nous ne pouvons pas uniquement faire porter le poids de ce changement aux consommateurs, car c’est un problème systémique. Il nous faut des réponses politiques au niveau national, en Suisse également.»
La Suisse doit rattraper son retard
La Suisse est en retard en ce qui concerne la responsabilité des entreprises dans le financement rde l’élimination des déchets qu’elles produisent. Le financement dédié au tri textile fait notamment défaut. «Nous fonctionnons grâce à 40% d’autofinancement et grâce aux subventions étatiques destinées à la réinsertion socio-professionnelle, explique Charlène Delhorme, cheffe de projet chez Démarche, la société gestionnaire de l’entreprise Textura. Dans tous les pays membres de l’UE, les centres de tri reçoivent des financements payés par ceux qui mettent des textiles sur le marché.» Sur le même principe, en France, le bonus réparation, en vigueur depuis décembre 2022, repose déjà sur les contributions des entreprises productrices de tous types de produits. Ce bonus permet aux consommateurs de bénéficier de réductions lorsqu’ils font réparer leurs objets. Depuis 2023, ce bonus s’applique également aux textiles.