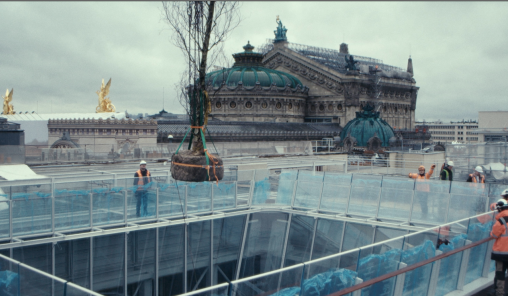ORTHOPÉDIE • On estime que 70% de la population présente ou a présenté un traumatisme au niveau de cette articulation très fragile, mais indispensable à notre mobilité. Sous-estimer la gravité d’une atteinte de la cheville peut cependant mener à d’importantes complications.
C’est une articulation un peu particulière. À la fois fragile, mais aussi très sollicitée parce qu’elle porte en permanence la totalité de notre corps. La cheville, car c’est d’elle qu’il s’agit, est une articulation complexe en forme de pince et qui comprend trois os: le tibia, le péroné et l’astragale, le tout enserré dans une capsule et un maillage ferme de ligaments. L’ensemble est évidemment destiné à assurer à la fois la mobilité, mais aussi la stabilité de l’articulation, si indispensable pour assurer la marche quotidienne et le sport, y compris sur des terrains glissants, mouvants ou incertains.
Et qui dit fragile, dit traumatismes fréquents, surtout à une époque où les loisirs de plein air sont pratiqués par un nombre de plus en plus élevé d’aficionados, parfois très âgés. Le plus fréquent de ceux-ci est évidemment l’entorse de la cheville – trois stades sont possibles: légère, modérée ou sévère - qui affecterait en Suisse plus de 750 personnes chaque jour.
L’entorse survient en général lorsque le pied se tord brusquement, le plus souvent vers l’intérieur, ce qui a pour effet d’étirer, voire de déchirer les ligaments. Dans d’autres cas, plus extrêmes, c’est carrément d’une fracture de l’un des os qu’il peut s’agir ou même d’une luxation de l’articulation.
Quand consulter?
Pour le patient, la principale difficulté en cas de traumatisme de la cheville, est de savoir quand consulter. Souvent bénin en apparence, celui-ci peut néanmoins, mal ou non pris en charge, se solder par des complications au long cours (récidives régulières, douleurs persistantes, voire arthrose, etc), dommageables à la fois pour le malade mais aussi pour les coûts non négligeables et évitables qu’elles peuvent induire pour le système de santé.
Alors quand consulter? En premier lieu, lorsque l’on entend un craquement qui signe toujours soit une fracture, soit une déchirure ou une rupture pure et simple d’un ligament. L’autre signal qui doit alerter est lorsque la cheville est «tordue» ou très gonflée, avec une ecchymose – les médecins parlent «d’œuf de pigeon» - qui peut être particulièrement douloureuse. Dans tous ces cas, il faut évidemment immédiatement consulter un médecin qui confirmera le diagnostic, par l’examen clinique, par une radio ou par une IRM en cas de besoin.
En revanche, lorsque ces signes sont absents, on peut dans un premier temps se «contenter» d’avoir recours à des antalgiques et surtout de mettre son pied au repos, avec de la glace, tout en surélevant la jambe afin de limiter la douleur. Si au bout d’une semaine, la cheville n’évolue pas bien et que les douleurs ou l’œdème ne s’atténuent pas, il faudra alors consulter le spécialiste qui mettra en œuvre à la fois des investigations plus poussées (radio, IRM) mais aussi selon les lésions identifiées, des traitements adéquats.
Selon, la gravité, la cheville pourra être immobilisée par une attelle durant plusieurs semaines, le tout assorti de séances de physiothérapie, ou dans les cas les plus graves, prise en charge chirurgicalement pour soigner d’éventuelles fractures ou réparer les ligaments déchirés.
La prévention bien sûr…
Le mieux, pour éviter tout cela est évidemment, comme toujours en matière de santé, de miser sur la prévention. Car en plus de l’attention portée aux sols sur lesquels on évolue, certaines mesures permettent de limiter le risque de survenue des traumatismes de la cheville. Ainsi en est-il d’éviter le port de talons ou l’usage de chaussures mal adaptées ou trop usées qui précarisent l’équilibre de cette articulation si indispensable à notre mobilité quotidienne.
L'Avis du spécialiste
Dr Nicolas Piette, Xpécialiste FMH Chirurgie orthopédique & Traumatologie de l’appareil locomoteurs
Que se passe-t-il quand une cheville gravement traumatisée n’est pas bien prise en charge?
Certains patients ont tendance à banaliser les traumatismes de la cheville et ils ont tort. Car mal pris en charge, ils peuvent conduire à une instabilité chronique de la cheville, à des douleurs chroniques ou même à de l’arthrose précoce, pour laquelle, contrairement au genou ou à l’épaule, les prothèses ne sont actuellement pas une option thérapeutique fiable. Il ne restera dans ce cas que l’arthrodèse, c’est-à-dire le fait de bloquer l’articulation, et il serait vraiment dommage d’en arriver là.
Certaines personnes sont-elles plus prédisposées que d’autres?
Oui. Les ligaments sont comme des élastiques et leur qualité est déterminée génétiquement, ce qui fait que certaines personnes peuvent souffrir d’hyperlaxité ligamentaire. Celle-ci, pour des raisons hormonales du reste, est d’ailleurs plus fréquente chez les femmes. D’autres personnes présentent des particularités anatomiques par exemple au niveau osseux, qui rendent plus fragile l’équilibre de la cheville.
En matière de traitement des traumatismes de la cheville, quel est le plus grand progrès observé ces dernières années?
Depuis des décennies, des dizaines de techniques chirurgicales ont fait leur preuve. Mais désormais, la chirurgie mini-invasive fondée sur l’arthoscopie permet de pratiquer des plasties ligamentaires et de réparer anatomiquement les ligaments. C’est une vraie révolution - la cheville est la dernière à en bénéficier après l’épaule et le genou -, et elle est appelée à se généraliser car elle permet un rétablissement plus rapide du patient.