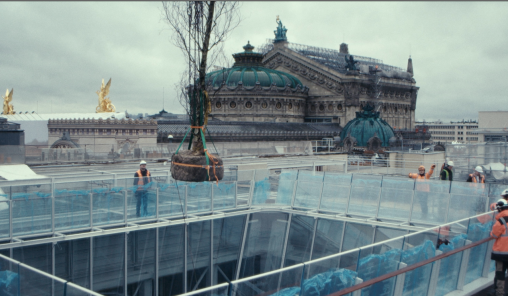VOYAGE • Du 12 au 19 octobre, treize jeunes filles fréquentant le centre socioculturel de Prélaz-Valency ont passé la semaine au Caire auprès des équipes du Samusocial international Égypte. Loin des lieux touristiques, elles se sont confrontées sept jours durant à la pauvreté de cette capitale de dix millions d’habitants. Reportage.
Dimanche 12 octobre, environ 4 heures du matin, arrivée à l’aéroport du Caire. Malgré l’heure nocturne, l’agitation extérieure est intense; bruit, trafic, klaxons. Notre interlocuteur sur place nous accueille. Youssef Bastawrous, directeur des opérations au Samusocial international Égypte, a organisé notre déplacement en bus dans un hôtel du quartier Al Daher.
C’est auprès de cette organisation – le Samusocial Égypte (SSIEG) – que treize Lausannoises, âgées de 15 à 20 ans, vont passer la semaine à la découverte du travail de ses équipes, accompagnées de Lucie Ravel et Franco De Guglielmo, animateurs au centre socioculturel de Prélaz-Valency. Une expédition dont la préparation a commencé il y a une année.
Premières maraudes
Premier jour. Après une visite du Vieux Caire en compagnie d’Amira Samir, responsable de la communication au SSIEG, nous prenons la direction des bureaux de l’organisation, situés dans le quartier de Maadi. Ici, Youssef Bastawrous présente aux treize filles les activités et l’historique de l’organisation. Implantée au Caire depuis 2008, elle assure une intervention auprès des enfants et des jeunes en situation de rue. Cinq soirs par semaine, une équipe composée de deux travailleurs sociaux et d’un médecin, effectue des rondes de nuit – des maraudes – en bus dans les quartiers du Caire, à la rencontre de la population défavorisée. Samira, Elsa, Hayate et Inès sont les premières à se lancer dans l’aventure des maraudes, en deux équipes. Nous sommes véhiculés par Ahmed et accompagnés d’Abdallah et du docteur Islam Fenon. Premier arrêt, le centre pour jeunes de Zeinhom, où l’équipe a l’habitude de se rendre pour jouer au foot avec les jeunes, avant de répondre si nécessaire à leurs besoins en matière de soins médicaux. C’est l’occasion pour les intervenants de prendre des nouvelles des jeunes.
Ce soir, peu d’enfants sont présents sur le terrain. «D’habitude il y a plus de monde, lance Abdallah, presque gêné. Je ne sais pas où ils sont tous passés.» Cela ne nous empêche pas de commencer à nous faire quelques passes, sous un beau ciel orangé de fin de journée. Au bout de quelques minutes, tout le monde se rassemble pour une grande partie de football. «Au début, je ne savais pas comment les aborder, raconte Elsa, 19 ans. Il y a la barrière de la langue, mais on ne sait pas s’ils ont envie de nous parler, comment ils nous perçoivent. Finalement, c’était un moment génial, j’ai beaucoup aimé cette expérience.»
Le sport qui rassemble
Mais il est déjà le moment de rejoindre un autre quartier, celui de Sayeda Zeinab. La rue grouille de monde, de lumières, de voitures. La ville est bruyante, poussiéreuse, et il y règne une odeur marquée de gaz d’échappement. «En voyant le niveau d’hygiène de ces jeunes, on prend une claque de réaliser que c’est comme ça qu’ils vivent tous les jours, et que la rue est leur environnement quotidien», poursuit Elsa. Inès, 18 ans, a également été touchée par l’expérience. «J’ai vu des enfants et même des bébés dehors, alors qu’ils méritent de vivre comme nous, d’aller à l’école, d’avoir une maison. Cela m’a plu de faire quelques activités avec eux, comme du coloriage, pour essayer de leur faire plaisir.» Mardi 14 octobre, Eliesa, Isra et Sabrina accompagnent Amira Samir au centre d’accueil de jour de la fondation Banati, partenaire du SSIEG. Dans cet endroit situé dans le quartier El-Gayara, dans le Vieux Caire, les mères sont accueillies une fois par semaine avec leurs enfants en bas âge. Amira est responsable de ce projet intitulé «baby wash». Ici, les enfants peuvent bénéficier d’un bain – le seul de la semaine - et de soins, avant de repartir avec une dizaine de couches-culottes offertes. «Au début, je n’étais pas très à l’aise, confie Eliesa, 17 ans. J’avais peur de mal faire avec les bébés. J’ai trouvé que c’était une expérience importante à vivre, car on ne se rend pas compte de la chance que nous avons en Suisse, d’avoir des soins ou de l’eau pour se laver.»
Le jour suivant, c’est dans un centre d’activités qu’une dernière partie du groupe – Yolia, Yasmina, Hira et Sheyla – se rend. Ouvert par le SSIEG en mars 2025 et basé sur la pédagogie Montessori, il propose un espace garderie pour les tout-petits et un espace de jeux libres pour les plus grands. Ils y sont accueillis par une enseignante spécialisée. «Je pensais que cela ressemblerait davantage à une école, mais c’était tout petit, et il n’y avait pas beaucoup d’enfants ce jour-là. Je pensais qu’ils y faisaient autre chose que jouer, comme apprendre à lire ou à écrire», explique Sheyla, 15 ans, visiblement un peu déçue. Un contraste entre l’attente et la réalité qui raconte encore un peu mieux l’écart entre grandir en Suisse ou en Égypte. Ici, l’accessibilité à ces jeux, destinés à stimuler apprentissages et capacités, n’est de loin pas à la portée de tous.
La visite du foyer d’hébergement du Centre Caritas, jeudi 16 octobre, a finalement réuni toutes les filles – jusque-là séparées en petits groupes - pour la dernière activité sociale de la semaine. Situé à Gizeh, le centre accueille 30 enfants «à risque» âgés de 6 à 16 ans; des enfants en situation de rue, orphelins, ou pour qui le contexte familial est dangereux. Cette activité restera la préférée de toutes les filles parce que les quelques heures passées sur place ont permis davantage de proximité avec les jeunes que les activités des jours précédents. «Nous avons joué au foot et au volley, et fait du coloriage. Cela nous a unies de faire du sport avec les enfants. Malgré la barrière de la langue, cela ne nous a pas empêchées de nous amuser», raconte Yasmina.
Autre réalité
Le dernier jour, la visite du site des pyramides de Gizeh a permis de clôturer la semaine sur une note plus légère, dont les filles gardent un souvenir mémorable. A notre retour, dimanche 19 octobre, elles sont heureuses de retrouver leurs familles, et la Suisse. «Le but d’un tel projet n’est pas seulement le voyage mais aussi tout le processus de préparation auquel elles ont participé, comme la récolte de fonds grâce à des ventes de pâtisseries, commente Lucie Ravel. Même si certaines auraient souhaité davantage d’activités touristiques, ce n’est pas l’objectif, et elles connaissaient le programme puisqu’elles ont participé à son élaboration. Ce genre de voyage permet justement de questionner nos modes de consommation, et de se confronter à une autre partie de la réalité d’un pays.»