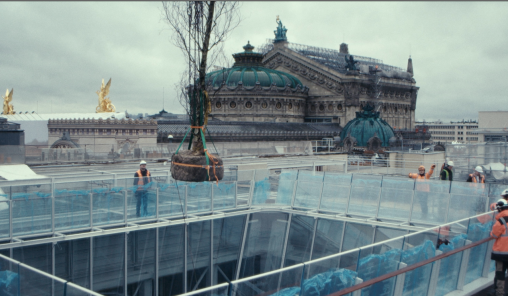NATURE • Face à la prolifération d’espèces exotiques en terres vaudoises, la biodiversité locale est en péril. Transportées par nos échanges mondiaux et renforcées par le dérèglement climatique, ces intrusions silencieuses menacent faune et flore indigènes. Pour Cleo Bertelsmeier, chercheuse à l’UNIL, il est urgent d’agir. Interview.
Moule quagga, araignée nosferatu ou encore frelon asiatique… la liste des animaux venus du Sud ayant trouvé un eldorado dans le Canton de Vaud ne cesse de se multiplier. Avec des conséquences négatives bien réelles, notamment pour la faune et la flore locales. C’est justement à cette problématique épineuse que s’intéresse Cleo Bertelsmeier, professeur au Département d’écologie et évolution de l’Université de Lausanne, à l’origine d’un ouvrage intitulé «Comment les animaux envahissent le monde».
Lausanne Cités: Des espèces exotiques qui se multiplient et se montrent parfois agressives. Faut-il s’en inquiéter?
Cleo Bertelsmeier: Oui, car, aujourd’hui, on dénombre près de 1305 espèces exotiques en Suisse, ce qui est énorme. Heureusement, parmi elles, toutes ne posent pas de gros problèmes, même s’il faut du temps pour étudier leur comportement. Toujours est-il que d’après le rapport de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 197 de ces espèces sont considérées comme invasives, soit environ 15%. Ce sont surtout ces dernières qui constituent une menace pour la biodiversité. On peut par exemple citer la pyrale du buis, un papillon pouvant provoquer d’énormes dégâts sur la végétation ou encore la Tapinoma magnum, une espèce de fourmi capable de réaliser des supercolonies. À noter que les humains ne sont pas forcément épargnés, certaines de ces espèces pouvant aussi véhiculer des maladies.
Comment ces espèces arrivent-elles sur le territoire vaudois?
Deux principales raisons ont été identifiées. La première concerne les achats volontaires, qui connaissent une forte hausse, notamment en ce qui concerne les invertébrés, les reptiles ou les oiseaux. Pourtant, ces animaux s’échappent parfois, ou peuvent être relâchés dans la nature par des propriétaires dépassés. Les gens oublient qu’une colonie de fourmis, bien que très sympathique, peut vivre une vingtaine d’années! La seconde porte d’entrée pour ces espèces: les voyages accidentels, essentiellement les transports de marchandises par bateau ou par avion. Heureusement, les traitements phytosanitaires se multiplient, par exemple pour traiter le bois. Mais cela reste limité. Souvent, il est possible d’éradiquer une invasion, mais seulement si elle est encore relativement récente.
Comment répondre à ces invasions? Faut-il se défendre?
Il est effectivement utile d’agir lorsque nous le pouvons, mais il faudra déterminer les priorités. Il faut pouvoir procéder au cas par cas. De manière générale, ce n’est pas un problème dont nous pourrons nous débarrasser entièrement. Je comprends donc que cela puisse paraître un peu désespérant, comme c’est le cas avec d’autres actions de protection de la nature. Mais si on sait agir pour limiter les dégâts, alors il faut le faire. Bien entendu, il faut aussi s’habituer à cette réalité des espèces exotiques, mais cela ne signifie pas qu’il faut arrêter le combat.
Concrètement, quelles possibilités existent?
Il faut tout d’abord s’informer le plus possible sur une espèce. Et ce pour une raison très simple: l’objectif consiste avant tout à éviter de faire plus de mal que de bien, ce qui est vite arrivé. Si l’on utilise un insecticide généraliste, il risque par exemple de tuer d’autres espèces. Même chose avec un appât, lui aussi susceptible d’attirer une espèce locale. Certains produits promus par des compagnies peuvent d’ailleurs se révéler davantage toxiques qu’attendu. Ici aussi, il s’agit de réaliser un important travail d’information avant d’entreprendre une action d’éradication.
En Suisse, plusieurs animaux sont régulés ou contenus par nos autorités. C’est le cas du loup ou encore du moustique tigre. Cela ne pose-t-il pas des questions d’éthique?
Effectivement, il y a un grand débat entre les défenseurs des droits des animaux et les personnes qui souhaitent la régulation ou l’éradication. Et il faut le reconnaître: les animaux sont des êtres sensibles, y compris les invertébrés, et sont capables de souffrance. Il peut donc être considéré comme cruel d’en tuer certains. Mais de l’autre côté, on a de nombreuses espèces locales qui souffrent de cette invasion, dans nos écosystèmes déjà extrêmement fragiles. Et si on ne fait rien, ce sont bien ces dernières qui pourraient en faire les frais. Une solution peut aussi consister à introduire des prédateurs ou parasites des espèces invasives. Mais attention! Là aussi, le risque est que ces espèces deviennent à leurs tours invasives. On l’a par exemple vu avec la coccinelle asiatique, devenue problématique dans certaines régions.
Avec le changement climatique, ces espèces risquent-elles d’être de plus en plus présentes?
Absolument. Jusqu’ici, de nombreuses espèces exotiques ne passaient pas l’hiver, les empêchant ainsi d’envahir le pays. Mais, de plus en plus, les conditions sont réunies pour permettre leur survie, notamment aux abords des lacs. Par exemple, le moustique tigre est désormais bien établi sous nos latitudes. Et puis, il faut savoir que notre manière d’aménager le territoire joue également un rôle capital. L’urbanisation, la transformation des habitats, l’agriculture... autant de réalités qui mettent une pression supplémentaire sur la biodiversité, en rendant nos écosystèmes moins résistants aux nouvelles invasions.